Intelligence humaine et Intelligence des LLMs : Mécanismes, Comparaisons et Perspectives
Le développement des LLM (Large Language Models) soulève inévitablement la question de leur comparaison avec l’intelligence humaine. Bien que les LLM produisent du langage naturel et accomplissent certaines tâches de façon parfois impressionnante, des différences majeures persistent, tant sur le plan des mécanismes que du mode de fonctionnement de ces deux formes d’intelligence.
Cet article propose une analyse comparative entre l’intelligence humaine et celle des LLM. Il expose les principes fondamentaux qui caractérisent chacune et met en évidence leurs points de convergence et de divergence, afin de clarifier les spécificités et les limites propres à chacune.
Intelligence humaine
De façon schématique, l’intelligence humaine repose sur l’interaction dynamique de plusieurs dimensions :
| Neurobiologique | ↔ | Cognitif | ↔ | Émotionnel |
|---|---|---|---|---|
| • Structure et fonctionnement du cerveau • Plasticité (neuronale, synaptique) • Régulation physiologique • Traitement et intégration sensorielle • Réflexes, automatismes, habiletés procédurales • Contrôle moteur et coordination • Embodiment (incarnation de la cognition) |
• Attention (sélective, soutenue, divisée) • Mémoires (sensorielle, de travail, sémantique, épisodique, procédurale) • Représentation mentale • Raisonnement (logique, critique, analogique) • Fonctions exécutives (planification, inhibition, flexibilité) • Langage (production, compréhension) • Apprentissage • Métacognition (simple, ses propres processus) • Conscience réflexive |
• Reconnaissance, compréhension, régulation des émotions (soi, autrui) • Expression et communication émotionnelle • Empathie • Motivation (intrinsèque-curiosité, extrinsèque-récompense/sanction) |
||
| ↕ | ||||
| Développemental | ↔ | Créatif et Réflexif | ↔ | Social & Culturel |
| • Apprentissage continu • Plasticité développementale • • Adaptation évolutive • Résilience face aux difficultés et traumatismes • Trajectoires de développement |
• Créativité et innovation • Pensée (divergente, convergente) • Génération d’idées nouvelles • Construction du sens • Réflexion critique • Métacognition avancée (réflexivité) • Imagination consciente |
• Communication (verbale, non verbale) • Transmission culturelle (traditions, valeurs, normes) • Apprentissage social (imitation, interaction, normes) • Intelligence collective, dynamique de groupe |
||
| ↕ | ||||
| Projection, Anticipation, Adaptation | ||||
| • Identité (personnelle, sociale, mémoire autobiographique) • Conscience de soi • Construction de modèles mentaux • Simulation mentale • Prise de perspective • Anticipation stratégique • Mémoire prospective, Planification • Décision morale et dimension éthique • Flexibilité comportementale et cognitive face à l’incertitude • Construction et révision des valeurs |
||||
| ↕ | ||||
| Diversité et Singularités | ||||
| • Neurodiversité (spectre autistique, haut potentiel, hypersensibilité, TDAH, etc.) • Variations individuelles, génétiques et environnementales • Talents exceptionnels, compétences spécifiques • Vulnérabilités, handicaps, conditions particulières |
||||
À la base, la structure et la plasticité du cerveau permettent le traitement des informations sensorielles, la coordination motrice, ainsi que la régulation des états internes. Ces bases biologiques soutiennent les fonctions cognitives telles que l’attention, la mémoire, le raisonnement, le langage et l’apprentissage.
La cognition humaine ne fonctionne pas de manière isolée : elle est modulée en permanence par les émotions, qui influencent la motivation, la prise de décision ou la capacité à apprendre.
La créativité et la pensée réflexive (la capacité à s’interroger sur ses propres processus mentaux) participent à la génération d’idées nouvelles et à la résolution de problèmes complexes.
L’intelligence humaine se manifeste aussi par la capacité à se projeter dans l’avenir, à anticiper, planifier et s’adapter à des situations nouvelles ou incertaines. Cela implique la construction de modèles mentaux, la prise de perspective (empathie, moralité) et la conscience de soi.
Le développement de l’intelligence s’inscrit dans un processus dynamique et continu : l’être humain s’adapte, développe des stratégies de résilience et explore des trajectoires singulières. Cette dynamique individuelle se nourrit de l’ancrage social et culturel : la communication, la transmission des savoirs, l’apprentissage par imitation et la participation à l’intelligence collective façonnent en profondeur chaque individu. L’intelligence n’est jamais figée : elle se construit dans la confrontation à la nouveauté, dans l’expérimentation, et dans la révision de ses propres valeurs et croyances.
Enfin, l’intelligence humaine se caractérise par sa diversité et ses singularités : chaque individu présente des variations liées à la neurodiversité, à ses expériences, à ses vulnérabilités ou à des talents spécifiques.
En résumé, l’intelligence humaine est une réalité multidimensionnelle : elle émerge de la rencontre entre biologie, expérience individuelle, contexte social et imagination créatrice. Aucune de ces dimensions ne peut être pensée indépendamment des autres.
Intelligence des LLM
| Neuroartificiel | ↔ | Cognitif |
|---|---|---|
| • Architecture de réseaux de neurones artificiels. • Plasticité limitée à l’entraînement initial |
• Représentation interne de l’information (vecteurs) • Mécanisme d’attention dans l’architecture • Apprentissage : uniquement entraînement initial • Langage : traiter, générer • Mémoire Sémantique (poids du LLM). • Mémoire de travail (tokens en entrée du LLM) |
|
| ↕ | ||
| Diversité et singularités des LLMs | ||
| • Différences d’architecture, de données d’entraînement, de taille des modèles • Finalités et usages variés selon les applications |
||
Les LLM sont des (très) gros réseaux neuronaux artificiels, entraînés sur de (très) larges volumes de textes. Leur fonction est de prédire la suite la plus probable d’une séquence de mots afin de générer un texte cohérent et adapté au contexte.
Le fonctionnement d’un LLM se déroule sur plusieurs étapes :
| 1. Tokenisation |
Le texte d’entrée est découpé en « tokens » (fragments de mots), afin d’être traité par le modèle. Ex : « Le chirurgien pose un implant et une prothèse. » Tokens : [“Le”, “chirurg”, “ien”, “pose”, …]→[234, 18293, 361, …] |
| 2. Représentation vectorielle (Embedding) |
Chaque token est converti en vecteur ; les mots proches en sens ont des vecteurs similaires. Ex : « implant »→[0.41, -0.12, 0.88, …]« prothèse »→[0.39, -0.09, 0.85, …]Cos(θ) ≈ 0.97 entre les deux vecteurs, indiquant une forte proximité sémantique |
| 3. Contexte & Attention |
Le modèle analyse les vecteurs et applique des mécanismes d’attention pour identifier les liens importants. Ex : « Après la pose du stent, une angioplastie peut être nécessaire. » Poids élevés entre stent et angioplastie, détectant la relation médicale. |
| 4. Génération de la réponse |
Le modèle prédit le prochain token selon les probabilités calculées. Ex : « Quels sont les risques d’un implant ? » Les→risques→associés→à→la→pose→d’→un→implant→incluent→… |
La génération de la réponse s’appuie non seulement sur la requête de l’utilisateur, mais aussi sur des couches contextuelles complémentaires :
- Alignement avec des règles éthiques et stylistiques internes
- Utilisation de « prompts » (instructions explicites)
- Prise en compte de l’historique conversationnel pour assurer la cohérence
- Possibilité d’intégrer des sources externes (base documentaire, API, web)
Simulation du Raisonnement
Les LLM peuvent simuler une réflexion structurée grâce à la technique dite de la « Chain of Thought » (enchaînement d’idées). Concrètement, ils génèrent des réponses étape par étape (« premièrement… », « ensuite… »), ce qui donne l’illusion d’un raisonnement organisé et méthodique.
Cette capacité provient en grande partie de leur entraînement, basé sur des exemples de raisonnements et de réflexions explicitées et détaillés. Ils apprennent ainsi à reproduire des chaînes de réflexion similaires à celles qu’on retrouve dans des explications humaines.
Un point critique concerne l’efficacité de cette technique : la puissance de la Chain of Thought repose sur la multiplication d’étapes intermédiaires, les modèles peuvent génèrer des chaînes bien plus longues que nécessaire, l’équivalent de centaines de pages, là où un humain parviendrait à la solution en quelques étapes grâce à son intuition et à son expérience. Par ailleurs, l’amélioration qualitative du raisonnement nécessite des efforts exponentiels, la complexité et la longueur s’accroissant pour des bénéfices marginaux.
Stratégies de Simulation de comportement humain
Pour imiter l’humain dans la conversation, les LLM exploitent différentes techniques, exemples :
- Reformulation des demandes pour démontrer l’écoute
- Respect de normes éthiques et sociales préprogrammées
- Adoption de rôles, de tonalités ou de styles adaptés au contexte
- Simulation d’empathie ou d’appréciation
- Usage du tutoiement ou du discours à la première personne
- Adoption d’expressions courantes ou d’humour
- Construction de réponses structurées étape par étape
Cependant, cette humanisation demeure superficielle : il s’agit d’une production statistique, sans conscience, intention, émotion authentique ni compréhension du sens..
AGI: l’intelligence artificial generale
Considérée comme le Graal par les concepteurs de modèles de langage, l’AGI (Artificial General Intelligence) demeure mal définie.
Selon OpenAI (et d’après les clauses de son contrat avec Microsoft), l’AGI est définie, comme
Une intelligence artificielle capable de générer au moins 100 millions de dollars de profits.
La norme ISO/IEC 22989 propose une définition plus technique, ici l’AGI désigne
Un système d’IA capable de traiter un large éventail de tâches en affichant un niveau de performance satisfaisant.
Mais dans l’imaginaire collectif, l’AGI est capable de
Réaliser n’importe quelle tâche intellectuelle aussi bien, voire mieux, qu’un être humain.
Perspectives : intégration des dimensions de l’intelligence humaine dans les systèmes hybrides LLM-logiciel
Les avancées récentes, à l’instar des travaux de Yann LeCun sur les “world models”, ouvrent de nouveaux horizons : il ne s’agit plus seulement d’accroître la puissance des LLM, mais de concevoir des systèmes hybrides capables d’intégrer diverses composantes de l’intelligence humaine.
Par exemple :
| Modélisation du monde et dimension cognitive | Systèmes dotés de modèles internes du monde : raisonnement causal, simulation de scénarios, anticipation, et apprentissage adaptatif. Combinaison de LLM, perception multimodale, logique, et simulation mentale. |
| Modularité et spécialisation (intelligence incarnée) | Architecture modulaire inspirée du cerveau : modules dédiés (perception, mémoire, raisonnement, action, éthique, émotion). Orchestration dynamique entre modules via API et agents spécialisés. |
| Mémoire externe, contextualisation et apprentissage continu | Intégration de bases de données externes et de moteurs d’indexation pour contextualisation dynamique. Apprentissage continu, adaptation en temps réel via fine-tuning local et adaptation contextuelle. |
| Simulation, planification et projection | Modules de simulation et moteurs de planification stratégique pour explorer et anticiper divers scénarios. |
Conclusion
L’intelligence humaine, fondée sur l’expérience individuelle, la conscience de soi et l’émotion, se distingue radicalement des LLM, strictement fondés sur des statistiques sans compréhension du monde.
Les avancées prochaines de l’intelligence artificielle émergeront probablement de l’hybridation entre modèles de langage et systèmes logiciels structurés. Cette convergence augure l’avènement de solutions capables de contextualiser, d’apprendre et d’interagir avec le réel, en s’inspirant de l’intelligence humaine.

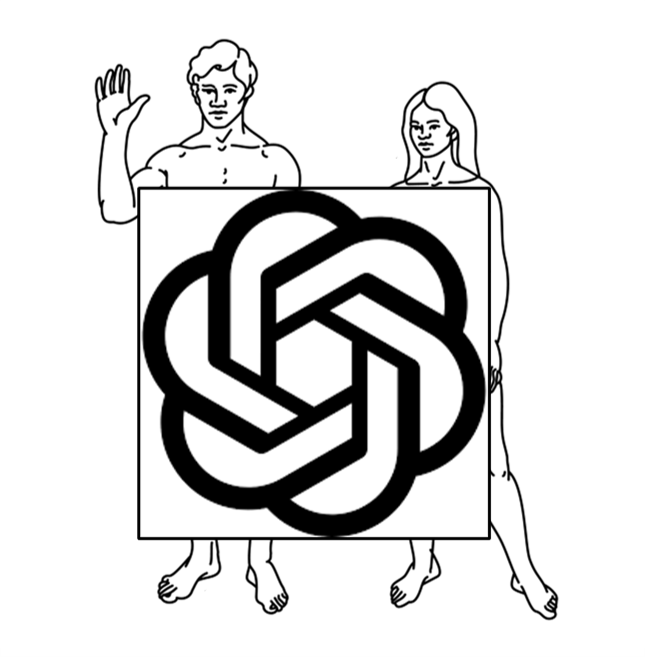
2 commentaires